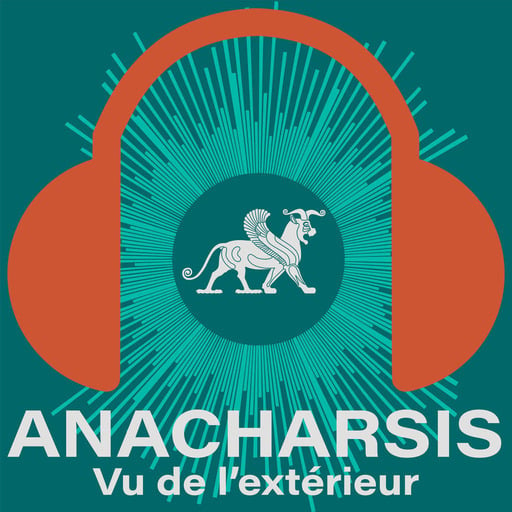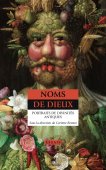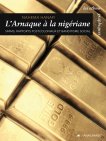"Mais qui a mis le feu?" Plutôt que de chercher à faire le portrait psychologique d’une personne qui serait mentalement dérangée, on revient avec Marie Desmartis sur son enquête intitulée Une chasse au pouvoir. Chronique politique d’un village de France où des incendies ont lieu.
Cette étude se passe entre Landiras et Origne en Gironde, plus précisément dans un village nommé Olignac pour l’occasion de la recherche afin de préserver l’anonymat des personnes qui se sont confiées à l'anthropologue.
Émission Le plat de résistance de la radio La Clé des ondes.
Entretien avec Rémi Philton.

Au cœur d’un village landais, une enquête sur la fabrique du politique, dans ses dimensions minuscules et essentielles, ses pratiques et ses effets, son histoire et ses violences.
Olignac est un petit village français des Landes de Gascogne. Au début des années 2000, les élections municipales plongent la commune dans une atmosphère délétère. Incendies nocturnes, chiens abattus, sourdes menaces. Le « clan des chasseurs », jusqu’alors dominant, vient de perdre le poste de maire et cherche à faire démissionner Mme Fortier, la nouvelle et vertueuse élue…
Marie Desmartis conduit son enquête au cœur de la municipalité en crise. Par une minutieuse description des rapports quotidiens de pouvoir, elle démonte pas à pas ce climat d’affrontement. Rumeurs, peurs et violences, s’emparent du village et de l’ethnographe elle-même.
À l’opposé d’une science politique glacée, Marie Desmartis procède à l’exégèse interne, à chaud, des luttes de pouvoir. La proximité aux acteurs et à leur histoire révèle, dans ce livre percutant, les ancrages, les variations et les excès des pratiques politiques de notre pays.